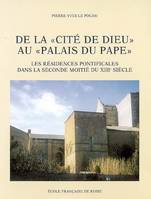- EAN13
- 9782728309993
- Éditeur
- Publications de l’École française de Rome
- Date de publication
- 02/05/2013
- Collection
- Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome
- Langue
- français
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
De la « Cité de Dieu » au « Palais du Pape »
Les résidences pontificales dans la seconde moitié du XIIIe siècle (1254-1304)
Pierre-Yves le Pogam
Publications de l’École française de Rome
Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome
Livre numérique
-
Aide EAN13 : 9782728309993
- Fichier PDF, libre d'utilisation
- Fichier EPUB, libre d'utilisation
- Fichier Mobipocket, libre d'utilisation
- Lecture en ligne, lecture en ligne
24.99
Autre version disponible
Par la multiplication des déplacements de la papauté dans la seconde moitié du
XIIIe siècle et par l’obligation faite à ses hôtes de lui bâtir de nouvelles
résidences, cette période représente un siècle d’or pour les constructions
civiles des pontifes. Le présent ouvrage est fondé sur l’étude monographique
des onze résidences principales de la papauté (palais et châteaux situés à
Rome, dans le Latium et en Ombrie), depuis les plus célèbres, comme les palais
du Latran et du Vatican, aux plus méconnus, tel le château de Soriano nel
Cimino, et s’appuie sur des textes multiples en partie inédits. Cette double
approche permet d’aborder tous les aspects de cette riche floraison dans une
double perspective, celle de l’histoire de l’architecture, mais aussi celle de
l’histoire tout court, car l’étude des résidences conduit à aborder l’histoire
de la cour pontificale, de la curie, de la papauté elle-même. Après l’étude
des monuments sont traitées la mise en œuvre des bâtiments, l’étude des
diverses parties de la résidence au service de la personne du pape et de
l’administration pontificale (depuis les grandes salles jusqu’à la chambre et
à la chapelle du pape), la typologie des palais et châteaux et leur insertion
dans leur tissu urbain respectif. Enfin est envisagé l’ensemble de l’activité
architecturale des pontifes, qui apparaît comme l’expression de l’ambition
universelle de l’Église du XIIIe siècle. Pourtant, à cause de l’instabilité
des séjours, de la brève durée de nombreux pontificats et des moyens encore
limités de la papauté et des communes qui la recevaient, le résultat présente
un aspect un peu anarchique, si on le compare au siècle suivant où une grande
partie des moyens sera concentrée dans l’élaboration d’un programme cohérent,
et l’ambition des pontifes se conclut sur un échec, avec l’attentat d’Anagni.
Mais c’est ce qui fait tout l’intérêt de cette période, qu’on peut voir comme
un temps d’expérience, de recherche, de tâtonnement, avant les temps de la
papauté et du palais d’Avignon.
XIIIe siècle et par l’obligation faite à ses hôtes de lui bâtir de nouvelles
résidences, cette période représente un siècle d’or pour les constructions
civiles des pontifes. Le présent ouvrage est fondé sur l’étude monographique
des onze résidences principales de la papauté (palais et châteaux situés à
Rome, dans le Latium et en Ombrie), depuis les plus célèbres, comme les palais
du Latran et du Vatican, aux plus méconnus, tel le château de Soriano nel
Cimino, et s’appuie sur des textes multiples en partie inédits. Cette double
approche permet d’aborder tous les aspects de cette riche floraison dans une
double perspective, celle de l’histoire de l’architecture, mais aussi celle de
l’histoire tout court, car l’étude des résidences conduit à aborder l’histoire
de la cour pontificale, de la curie, de la papauté elle-même. Après l’étude
des monuments sont traitées la mise en œuvre des bâtiments, l’étude des
diverses parties de la résidence au service de la personne du pape et de
l’administration pontificale (depuis les grandes salles jusqu’à la chambre et
à la chapelle du pape), la typologie des palais et châteaux et leur insertion
dans leur tissu urbain respectif. Enfin est envisagé l’ensemble de l’activité
architecturale des pontifes, qui apparaît comme l’expression de l’ambition
universelle de l’Église du XIIIe siècle. Pourtant, à cause de l’instabilité
des séjours, de la brève durée de nombreux pontificats et des moyens encore
limités de la papauté et des communes qui la recevaient, le résultat présente
un aspect un peu anarchique, si on le compare au siècle suivant où une grande
partie des moyens sera concentrée dans l’élaboration d’un programme cohérent,
et l’ambition des pontifes se conclut sur un échec, avec l’attentat d’Anagni.
Mais c’est ce qui fait tout l’intérêt de cette période, qu’on peut voir comme
un temps d’expérience, de recherche, de tâtonnement, avant les temps de la
papauté et du palais d’Avignon.
S'identifier pour envoyer des commentaires.